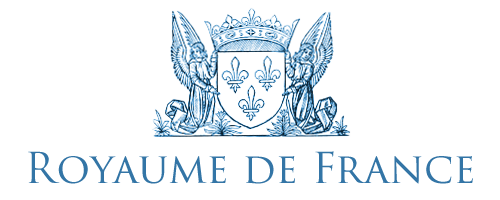R.P. HENRI-DOMINIQUE LACORDAIRE
DISCOURS SUR LA VOCATION DE LA NATION FRANÇAISE
PRONONCÉ À NOTRE-DAME DE PARIS, LE 14 FÉVRIER 1841,
POUR L’INAUGURATION DE L’ORDRE DES FRÈRES PRÊCHEURS EN FRANCE.
Monseigneur (Monseigneur Affre, archevêque de Paris),
Messieurs,
C’est Dieu qui a fait les peuples et qui leur a partagé la terre, et c’est aussi Lui qui a fondé au milieu d’eux une société universelle et indivisible; c’est lui qui a fait la France, et qui a fondé l’Église. De telle sorte que nous appartenons tous à deux cités, que nous sommes soumis à deux puissances, et que nous avons deux patries: la cité éternelle et la cité terrestre, la puissance spirituelle et la puissance temporelle, la patrie du sang et la patrie de la foi.
Et ces deux patries, quoique distinctes, ne sont pas ennemies l’une de l’autre; bien loin de là: elles fraternisent comme l’âme et le corps fraternisent, elles sont unies comme l’âme et le corps sont unis; et, de même que l’âme aime le corps, bien que le corps se révolte souvent contre elle, de même la patrie de l’éternité aime la patrie du temps et prend soin de sa conservation, bien que celle-ci ne réponde pas constamment à son amour.
Mais il peut arriver que la cité humaine se dévoue à la cité divine, qu’un peuple s’honore d’une alliance particulière avec l’Église: alors l’amour de l’Église et l’amour de la patrie semblent n’avoir plus qu’un même objet; le premier élève et sanctifie le second, et il se forme de tous deux une sorte de patriotisme surnaturel, dont saint Paul nous a donné l’exemple et l’expression dans ces sublimes paroles de son Épître aux Romains:
Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience me rendant témoignage dans l’Esprit-Saint: j’ai dans le coeur une tristesse grande et une douleur qui ne cesse pas; car je souhaitais d’être séparé du Christ par l’anathème, en faveur de mes frères qui sont mes parents selon la chair, qui sont israélites, de qui est l’adoption des enfants, et la gloire, et le testament, et la législation, et le service, et les promesses; de qui sont les pères, de qui est le Christ selon la chair, le Christ, Dieu béni par-dessus toutes choses, dans les siècles des siècles (IX, 1 et sv).
Il était impossible d’exprimer plus énergiquement l’amour de la patrie surnaturalisé par la foi; et, du reste, tous les prophètes sont remplis de ces élans patriotiques, depuis David s’écriant : Seigneur, Vous Vous lèverez, Vous aurez pitié de Sion, parce que le temps d’en avoir pitié est venu, parce que ses pierres ont plu à Vos serviteurs (Ps. 101, 14-15); jusqu’à Jésus-Christ pleurant à la vue de Jérusalem, et disant avec une si pieuse douleur: Ah! si tu avais connu, même en ce jour, qui est encore le tien, ce qui peut te donner la paix (Luc, 19, 42)!
Or, Messieurs, je me propose d’examiner devant vous jusqu’à quel point notre pays lui-même mérite un semblable sentiment, jusqu’à quel point nous devons l’aimer, non seulement comme Français, mais comme chrétiens. Il n’est pas sans importance, dans la situation générale du monde, de traiter cette question, et de chercher, en regardant l’histoire et le siècle présent, quel est le peuple à qui l’Église doit le plus dans le passé, et de qui elle peut attendre davantage dans l’avenir. L’espérance est une vertu, et quand du sein de Dieu elle pousse ses rejetons à travers la patrie, sa sève, pour être plus douce encore, ne perd point sa divinité.
Il y a longtemps, Messieurs, que Dieu a disposé des nations. Le jour même, ce jour éternel, où il disait à son Fils: Tu es Mon Fils, Je T’ai engendré aujourd’hui; Il ajoutait immédiatement: Demande-Moi, et Je Te donnnerai les nations pour Ton héritage (Ps. 2, 7-8). Ainsi le Fils de Dieu recevait en même temps de Son Père la substance divine et le domaine des choses créées, la filiation et l’hérédité, selon cette autre parole, qui est de saint Paul: Dieu nous a parlé par Son Fils, qu’Il a établi l’héritier de tout (Hb., I, 2). Et pour le dire en passant, c’est dans ces profondeurs de la paternité et de l’hérédité divines que se cache la source de la paternité et de l’hérédité humaines: lois mystérieuses, qui, venant de si haut, sont plus fortes que nous, et le fondement même de l’ordre humain.
Les nations étant de toute éternité le patrimoine du Fils de Dieu, qu’en fera-t-Il ? De même qu’un bon maître cultive et féconde sa terre avant de lui rien demander, le Fils de Dieu fait homme est venu dans le monde pour visiter les nations, Son patrimoine, leur a donné avant de rien leur demander. Et voici les dons qu’Il leur a faits, en tant que nations:
Premièrement, le don du pouvoir temporel, en retenant pour Lui le pouvoir spirituel. Il eût pu les garder tous deux, et gouverner directement par Lui-même ou par Ses ministres les sociétés humaines; Il ne l’a pas voulu. Il a permis aux nations de se donner des chefs, de se régir chacune par ses lois et ses magistrats, et de même que, selon l’expression de l’Écriture, Dieu avait traité l’homme avec respect (Sagesse, XII, 18), en lui donnant la liberté morale, Il a traité les nations avec respect en leur donnant par Son Fils la liberté politique. Allez, leur a-t-Il dit, vous êtes dans la main de votre conseil; vous tenez le sceptre; frappez-en la terre, qu’elle ressente votre action; soyez l’artisan de vos destinées sociales: mais souvenez-vous qu’il est une limite à votre autorité, et qu’en vous communiquant le pouvoir temporel, J’ai retenu pour Moi le pouvoir spirituel, non pour vous l’interdire, puisque J’ai choisi Mes ministres parmi vous, mais de peur que vous n’abusiez de cette double puissance, si j’avais couvert la même tête de la majesté du temps et de celle de l’éternité.
Le second bienfait dispensé par le Fils de Dieu à Son héritage, lorsqu’Il est venu le visiter, a été une modification dans la nature même du pouvoir, ou plutôt le rappel de ce pouvoir à sa primitive constitution. Un jour, les Apôtres étant assemblés autour du Sauveur, Notre-Seigneur leur adressa ces belles et aimables paroles:
Vous savez que les princes des nations dominent sur elles, et que les plus grands sont ceux qui exercent la puissance à leur égard; il n’en sera pas ainsi parmi vous. Que celui d’entre vous qui veut être grand soit votre ministre, et que celui qui veut être le premier soit votre serviteur, à la ressemblance du Fils de l’homme, qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir (Matt., XX, 25 et sv.).
A dater de ce moment, le pouvoir a perdu le caractère de domination pour s’élever à l’état de service public et le dépositaire de la plus haute royauté qui soit dans le monde, la royauté spirituelle, s’est appelé volontairement le serviteur des serviteurs de Dieu.
Jésus-Christ avait réglé et adouci la souveraineté. Il voulut régler et adoucir les rapports des citoyens entre eux, et des nations avec les nations. Il déclara que les hommes étaient des frères, et les nations des soeurs, qu’il n’y avait plus de Gentil ni de Juif, de circoncis ni d’incirconcis, de Barbare ri de Scythe, d’esclave ni d’homme libre (Col., III, 11).
Voilà la charte, Messieurs, la grande charte, la charte éternelle, que le Fils de Dieu a donnée aux nations en prenant possession de Son héritage. On n’ira jamais plus loin. On essaiera de nier ces principes; on essaiera aussi de les fausser par des conséquences qu’ils ne contiennent pas: l’esprit de domination et l’esprit de licence les combattront à l’envi: celui-ci comme insuffisants, celui-là comme destructeurs de la majesté; mais cette double inimitié sera leur force et leur justification. Chez tout peuple qui ne retournera point à la barbarie, la souveraineté demeurera un service public borné à l’ordre temporel, les rapports d’homme à homme et de nation à nation un rapport de fraternité.
A côté du bénéfice se placent ordinairement les charges. Jésus-Christ avait servi les nations, Il avait droit de leur demander service à son tour. Ce service, c’était d’accepter la loi de Dieu proposée à leur libre arbitre, de l’aimer, de la conserver, de la défendre, de la propager, d’en faire le fond de leurs moeurs et de leurs institutions, d’user même de leurs armes, non pour l’imposer, mais pour la préserver et la tirer de l’oppression, en assurant à tous les hommes le droit de la connaître et de s’y conformer librement. La vocation d’un peuple n’était plus d’étendre ses frontières au préjudice de ses voisins; ç’avait été la gloire des peuples païens, du peuple romain, le plus grand de tous: mais qu’était-ce que cette gloire? des larmes et du sang. Cela était bon pour des races que le christianisme n’avait point encore touchées de son doigt. La vocation des races chrétiennes, c’était de répandre la vérité, d’éclairer les nations moins avancées vers Dieu, de leur porter, au prix du travail et au hasard de la mort, les biens éternels, la foi, la justice, la civilisation.
A cette pensée, mes entrailles d’homme s’émeuvent; je reconnais un but digne du ciel et de la terre, de l’intervention de Dieu et de l’activité du genre humain, et je m’assure, Messieurs, que personne parmi vous ne me contredit, fût-il même incroyant. Car, si le christianisme a cessé d’être votre maître et votre instituteur, il respire encore dans vos sentiments, il élève encore votre intelligence; si vous n’êtes plus chrétiens par la face qui regarde Dieu, vous l’êtes plus que jamais par la face qui regarde l’homme.
Chose triste à dire! Les nations n’acceptèrent pas plus les charges que les bénéfices du contrat qui leur avait été proposé. En même temps qu’elles exagéraient la souveraineté jusqu’à lui abandonner les choses divines, et qu’elles détruisaient la fraternité par la servitude, elles accablaient aussi la vérité sous la fable, élevant dans l’histoire ces fameuses sociétés idolâtriques où la guerre, l’oppression et l’erreur se disputaient à qui déshonorerait davantage l’humanité.
Dieu, voyant les peuples s’éloigner de Lui, en choisit un, Il le forma Lui-même, annonçant au premier de ses ancêtres, le grand Abraham, que toutes les nations seraient bénies en lui, afin que sa postérité ne se crût pas seule aimée et seule appelée. Mais ce peuple que Dieu avait pétri, qu’Il avait tiré de l’esclavage, auquel Il avait donné des lois, préparé un territoire, dont Il avait dessiné le temple et consacré les prêtres, ce peuple fut infidèle à sa vocation; après avoir de siècle en siècle lapidé les prophètes du Seigneur, quand le Seigneur vint Lui-même, quand la Vérité vivante apparut sur la terre, il se leva comme Caïn, et mit entre Dieu et Lui l’abîme du sang, abdiquant par ce crime l’honneur suprême d’avoir été la première des nations vouée, en tant que nation, à la défense, à la conservation et à la propagation de la vérité.
Cependant le christianisme se répand dans le monde, il envahit l’empire romain; trois siècles de persécutions ne font qu’accroître sa force ; il porte Constantin sur le trône, et Constantin l’associe à la majesté souveraine qu’il a reçue de lui. Toutefois, près de deux cents ans après Constantin, il n’y avait pas encore au monde de nation chrétienne. L’empire était formé de vingt races diverses rapprochées par un lien administratif, mais séparées par leurs souvenirs et leurs moeurs, et au sein desquelles l’arianisme, hérésie féconde et vivace, avait jeté un nouveau germe de division. Les peuplades barbares, qui serraient de près l’empire romain avec une convoitise toujours croissante, étaient adonnées à l’idolâtrie ou subjuguées par l’arianisme, qui avait trouvé le secret de pénétrer jusqu’à elles. Alors, écoutez ce que Dieu fit.
Non loin des bords du Rhin, un chef barbare livrait bataille à d’autres barbares : ses troupes plient; il se souvient dans le péril que sa femme adore un Dieu dont elle lui a vanté la puissance. Il invoque ce Dieu, et, la victoire ayant suivi sa prière, il court se prosterner devant le ministre du Dieu de Clotilde: «Doux Sicambre, lui dit saint Remy, adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré». Ce Dieu, Messieurs, c’était le Christ; ce roi, cette reine, cet évêque, cette victoire, c’était la nation franque, et la nation franque était la première nation catholique donnée par Dieu à Son Église. Ce n’est pas moi qui décerne cette louange magnifique à ma patrie ; c’est la papauté, à qui il a plu, par justice, d’appeler nos rois les fils aînés de l’Église. De même que Dieu a dit à Son Fils de toute éternité: Tu es Mon premier né, la papauté a dit à la France: Tu es ma fille aînée. Elle a fait plus, s’il est possible; afin d’exprimer plus énergiquement ce qu’elle pensait de nous, elle a créé un barbarisme sublime: elle a nommé la France le Royaume christianissime, – Christianissimum regnum. Ainsi, primogéniture dans la foi, excellence dans la foi, tels sont nos titres, telle était notre vocation.
Y avons-nous répondu? Car il ne suffit pas d’être appelé, il faut répondre à sa vocation. Avons-nous répondu à la nôtre? C’est demander ce que notre patrie a fait pour Jésus-Christ et Son Église.
L’Église a couru trois périls suprêmes: l’arianisme, le mahométisme, le protestantisme; Arius, Mahomet, Luther, les trois grands hommes de l’erreur, si toutefois un homme peut être appelé grand lorsqu’il se trompe contre Dieu.
L’arianisme mit en question le fond même du christianisme, car il niait la divinité de Jésus-Christ, et la divinité de Jésus-Christ, c’est tout le christianisme. Si en effet l’arianisme dit vrai, Jésus-Christ n’est plus qu’un grand homme qui a eu des idées, et qui est mort pour ses idées. Or, cela s’est vu, et pour l’honneur de l’humanité, cella se verra encore; c’est l’histoire de Socrate. Mais, mourir quand on est Dieu, quand on peut ne pas mourir, quand on a la toute-puissance pour faire régner ses idées; mourir afin de susciter l’amour dans les coeurs, voilà ce que les hommes ne font pas, ce qu’a fait Jésus-Christ, et ce qui constitue le mystère du christianisme, mystère né de l’amour pour produire l’amour.
Arius fut soutenu dans son hérésie par le rationalisme et l’esprit de cour; le rationalisme, qui s’accommodait naturellement d’un philosophe substitué à un Dieu; l’esprit de cour, qui était effrayé de la croix, et qui, en la transportant d’un Dieu à un homme, croyait en éloigner de ses viles épaules le rude fardeau. Le rationalisme prêta aux ariens l’appui d’une dialectique subtile; l’esprit de cour, la double force de l’intrigue et de la violence. Cette combinaison mit l’Église à deux doigts de sa perte, si toutefois il est permis d’user de pareilles expressions, de ne juger que d’après la superficie des choses, d’oublier que le christianisme a en soi une puissance infinie de dilatation, et qu’il la conserve toujours, alors même que les yeux infirmes de l’homme le croient anéanti, comme si dans l’invisible unité d’un point mathématique ne pouvaient pas tenir des mondes. Mais, sans aller jusqu’à des expressions qui sembleraient douter de l’immortalité de l’Église, toujours est-il que le succès de l’arianisme fut immense, et qu’après avoir corrompu une partie de l’Orient, il menaçait l’Occident par les Barbares, qui, en y portant leurs armes, y portaient son esprit. Ce fut alors que notre aïeul Clovis reçut le baptême des mains de saint Remy, et que, chassant devant lui les peuplades ariennes, il assura en Occident le triomphe de la vraie foi.
L’arianisme penchant vers son déclin, Mahomet parut. Mahomet releva l’idée d’Arius à la pointe du cimeterre. Il voulut bien reconnaître que Jésus-Christ était un grand prophète; mais, comme son prédécesseur, il en nia la divinité. Il lui sembla qu’Arius n’avait pas assez donné à la corruption, il lui donna davantage; et ce moyen ne devant pas suffire à la conversion de l’univers, il déchaîna les armes. Bientôt le mahométisme attaquait par tous les points à la fois la chrétienté. Qui l’arrêta dans les champs de Poitiers? Encore un de vos aïeux, Charles-Martel. Et plus tard, le péril ne faisant que s’accroître avec les siècles, qui songea à réunir l’Europe autour de la croix, pour la précipiter sur cet indomptable ennemi? Qui eut le premier l’idée des croisades? Un pape français, Sylvestre II. Où furent-elles d’abord inaugurées? Dans un concile national, à Clermont; dans une assemblée nationale, à Vézelay. Vous savez le reste, ces deux siècles de chevalerie, où nous eûmes la plus grande part dans le sang et dans la gloire, et que couronne glorieusement saint Louis mourant sur la côte africaine.
Après ces deux honteuses défaites, le démon comprit qu’il n’atteindrait jamais son but en s’attaquant directement à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ et l’Évangile, c’est la même chose, et l’Évangile va trop droit au coeur des hommes pour espérer de l’y détrôner. Mais l’Église, ce n’est plus Jésus-Christ qu’indirectement; elle est composée d’hommes sujets aux faiblesses et aux passions de l’humanité: on pouvait peut-être, dans ce côté humain, ruiner l’oeuvre divine. Luther vint au monde; à sa voix l’Allemagne et l’Angleterre se séparèrent de l’Église, et si une grande nation de plus, si la France eût suivi leur terrible invitation, qui peut dire, le miracle à part, ce que fût devenue la chrétienté? La France n’eut pas seulement la gloire de se tenir ferme dans la foi; elle eut à combattre dans son propre sein l’expansion de l’erreur représentée par Calvin, et la révolte d’une partie de sa noblesse, un moment appuyée de la royauté. L’élan national la sauva ; on la vit, confédérée dans une sainte ligue, mettre sa foi plus haut que tout, plus haut même que la fidélité à ses souverains, et ne consentir à en reconnaître l’héritier légitime qu’après que lui-même eut prêté serment au Dieu de Clovis, de Charlemagne et de saint Louis.
Tel fut le rôle de la France dans les grands périls de la chrétienté ; ainsi acquitta-t-elle sa dette de fille aînée de l’Église. Encore n’ai-je pas tout dit. Au moment où la papauté, à peine délivrée des mains tortueuses du Bas-Empire, était menacée de subir le joug d’une puissance barbare, ce fut la France qui assura sa liberté et sa dignité par ses armes d’abord, ensuite et d’une manière définitive par une dotation territoriale à laquelle était annexée la souveraineté. Le chef de l’Église, grâce à Charlemagne, cessa de dépendre d’une autorité qui, moins que jamais, par la formation des peuples modernes, gardait un caractère d’universalité, et il put étendre sur les nations, dont il était le père commun, un sceptre pacifique où tous eussent la joie de ne plus lire que le nom de Dieu. Ce grand ouvrage fut le nôtre: je dis le nôtre, car nos pères, n’est-ce pas nous ? Leur sang n’est-il pas notre sang, leur gloire notre gloire ? Ne vivons-nous pas en eux, et ne revivent-ils pas en nous ? N’ont-ils pas voulu que nous fussions ce qu’ils étaient, une génération de chevaliers pour la défense de l’Église ?
Nous pouvons donc le dire, confondant par un orgueil légitime les fils avec les pères, nous avons accepté le contrat proposé par le Fils de Dieu au libre arbitre des nations: nous avons connu, aimé, servi la vérité. Nous avons combattu pour elle les combats du sang et de l’esprit. Nous avons vaincu Arius, Mahomet, Luther, et fondé temporellement la papauté. L’arianisme défait, le mahométisme défait, le protestantisme défait, un trône assuré au pontificat, voilà les quatre couronnes de la France, couronnes qui ne se flétriront pas dans l’éternité. De même que le prêtre, les apôtres, les docteurs, les vierges, les martyrs, ont dans le ciel leur signe distinctif, parce que rien ne se perd de ce qui est fait pour le Seigneur, et que nous retrouvons près de Lui la gloire que nous Lui rendons sur la terre, pourquoi les peuples fidèles, les peuples serviteurs de Dieu, ne conserveraient-ils pas à jamais le signe de leurs services et de leurs vertus ? Les liens de famille ne sont pas brisés dans le ciel; Jésus-Christ, en élevant Sa Mère au-dessus des saints et des anges, nous a fait voir que la piété filiale est une vertu de l’éternité. Pourquoi les liens des nations seraient-ils rompus? Pourquoi ne reconnaîtrions-nous pas nos chevaliers, nos rois, nos prêtres, nos pontifes, à un caractère qui rappelât leurs travaux communs pour le Seigneur ou pour Son Christ? Oui, j’aime à le croire, sur leur robe nuptiale, lavée dans le sang de l’Agneau, brilleront, ineffaçables et merveillement tissues, les quatre couronnes de la France.
Je suis long peut-être, Messieurs, mais c’est votre faute, c’est votre histoire que je raconte : vous me pardonnerez, si je vous ai fait boire jusqu’à la lie ce calice de gloire.
Comme tous les peuples, la France avait été appelée : la France, nous l’avons vu, la première entre toutes les nations et au-dessus de toutes les autres, répondit à sa vocation. Mais il ne suffit pas de répondre à sa vocation, il faut persévérer. La France a-t-elle persévéré? A cette question, Messieurs, j’ai à faire une triste, une cruelle réponse; je la ferai. Je dirai le mal, comme j’ai dit le bien; je blâmerai, comme j’ai loué, toujours sans exagération, mais toujours avec énergie.
En suscitant Luther, en inventant le protestantisme, l’esprit de ténèbres savait ce qu’il faisait: il avait bien prévu que des peuples longtemps nourris de la doctrine divine seraient bientôt rassasiés de cette doctrine humaine. Il avait calculé qu’après avoir pris le mensonge pour la vérité, les hommes seraient amenés par le dégoût du mensonge au dégoût de la vérité même, et que des abîmes de l’hérésie ils tomberaient dans les abîmes de l’incrédulité. Le protestantisme, d’ailleurs, n’était pas une hérésie ordinaire; il ne niait pas seulement un dogme particulier, mais l’autorité même, qui est le soutien du dogme, et sans laquelle il n’est plus qu’un produit de la raison. La raison, exaltée, devait tôt ou tard s’affranchir des derniers langes de la foi, et le protestantisme tomber dans le rationalisme.
Ce fut ce qui arriva, et ce qui arriva par l’Angleterre, la grande nation protestante. A Dieu ne plaise que j’en parle avec amertume! Lorsque je pense à tout ce qu’il faut de travaux, de vertus, d’héroïsme, pour faire un peuple et perpétuer sa vie, je m’en voudrais mortellement d’abuser de la parole contre une nation. Mais si l’injure est indigne, la vérité ne l’est jamais. Nous ne pouvons cacher les fautes que tout l’univers a connues; et, résolu de ne pas taire les nôtres, il nous est permis de rappeler de qui nous en reçûmes l’exemple. Ce fut donc en Angleterre que l’incrédulité naquit. La France alla l’y chercher, et, une fois qu’elle en eut rapporté le germe, il mûrit sur son sol avec une rapidité et sous une forme qui ne s’étaient jamais vues. Jusque-là, quand on attaquait la religion, on l’attaquait comme une chose sérieuse; le dix-huitième siècle l’attaqua par le rire. Le rire passa des philosophes aux gens de cour, des académies dans les salons; il atteignit les marches du trône; on le vit sur les lèvres du prêtre; il prit place au sanctuaire du foyer domestique, entre la mère et les enfants. Et de quoi donc, grand Dieu! de quoi riaient-ils tous? Ils riaient de Jésus-Christ et de l’Évangile! Et c’était la France!
Que fera Dieu? Ici, Messieurs, je commence à entrer dans les choses contemporaines; il ne s’agit plus du passé, mais de ce que vos yeux ont vu. Plaise à la Sagesse d’où découle la nôtre que je ne dise rien qui ne soit digne d’être entendu par une assemblée d’hommes qui estiment la vérité!
La France avait trahi son histoire et sa mission; Dieu pouvait la laisser périr, comme tant d’autres peuples déchus, par leur faute, de leur prédestination. Il ne le voulut point; Il résolut de la sauver, par une expiation aussi magnifique que son crime avait été grand. La royauté était avilie: Dieu lui rendit sa majesté, Il la releva sur l’échafaud. La noblesse était avilie: Dieu lui rendit sa dignité, Il la releva dans l’exil. Le clergé était avili: Dieu lui rendit le respect et l’admiration des peuples, Il le releva dans la spoliation, la misère et la mort. La fortune militaire de la France était avilie: Dieu lui rendit sa gloire, Il la releva sur les champs de bataille. La papauté avait été abaissée aux yeux des peuples: Dieu lui rendit sa divine auréole, Il la releva par la France.
Un jour les portes de cette basilique s’ouvrirent, un soldat parut sur le seuil, entouré de généraux et suivi de vingt victoires. Où va-t-il? Il entre, il traverse lentement cette nef, il monte devant le sanctuaire; le voilà devant l’autel. Qu’y vient-il faire, lui, l’enfant d’une génération qui a ri du Christ? Il vient se prosterner devant le Vicaire du Christ, et lui demander de bénir ses mains afin que le sceptre n’y soit pas trop pesant à côté de l’épée; il vient courber sa tète militaire devant le vieillard du Vatican, et confesser à tous que la gloire ne suffit pas, sans la religion, pour sacrer un empereur. Il avait compris, malgré toutes les apparences contraires, que le souffle divin ne s’était point retiré de la France, et c’est là vraiment le génie, de ne pas s’arrêter à la superficie des choses, mais d’aller au fond en surprendre la réalité cachée. C’est là vraiment gouverner les peuples, de ne pas croire à leurs mauvais penchants, et de leur révéler à eux-mêmes ce qui reste en eux de grand et de bon. Ainsi Dieu sauva-t-il la France, ainsi releva-t-Il tout ce qu’elle avait abattu; ainsi l’environna-t-Il de la majesté du malheur et de l’expiation.
Un peuple traité de la sorte est-il un peuple abandonné? Le signe de la résurrection n’est-il pas visiblement sur nous? Comptez, s’il vous est possible, les oeuvres saintes qui, depuis quarante ans, élèvent dans la patrie leur tige florissante. Nos missionnaires sont partout, aux échelles du Levant, en Arménie, en Perse, aux Indes, en Chine, sur les côtes d’Afrique, dans les îles de l’Océanie; partout leur voix et leur sang parlent à Dieu du pays qui les verse sur le monde. Notre or court aussi dans tout l’univers, au service de Dieu; c’est nous qui avons fondé l’Association pour la Propagation de la Foi, ce trésor de l’apostolat tiré sou par sou de la poche du pauvre, et qui porte chaque année des ressources royales aux missions les plus lointaines de la vérité. Les Frères des écoles chrétiennes, revêtus de leur humble habit, traversent incessamment les rues de nos villes, et, au lieu des outrages qu’ils y recevaient trop souvent, ils n’y rencontrent plus que les regards bienveillants de l’ouvrier, le respect des chrétiens, et l’estime de tous. Apôtres obscurs du peuple de France, ils y créent sans bruit, en mêlant Dieu à l’enseignement élémentaire, une génération qui reconnaît dans le prêtre un ami, et dans l’Évangile le livre des petits, la loi de l’ordre, de la paix, de l’honneur et de la fraternité universelle. L’enfance même ne reçoit pas seule leurs leçons; ils ont appelé à eux l’adulte, et réconcilié le froc avec la veste de hure, la rude main du travailleur terrestre avec la main modeste du travailleur religieux.
Voulez-vous voir un spectacle plus consolant encore, et qui n’avait pas de modèle dans l’ancienne France? Regardez, voici des adolescents, des étudiants, des jeunes hommes placés à l’entrée de toutes les carrières civiles et industrielles, sans distinction de naissance et de fortune; la charité chrétienne les a réunis, non pour assister le pauvre d’un argent philanthropique, mais pour le visiter, lui parler, le toucher, voir et sentir sa misère, et lui porter, avec le pain et le vêtement, le visage pieux d’un ami. Chaque ville, sous le nom de Conférence de Saint- Vincent-de-Paul, possède une fraction de cette jeune milice, qui a placé sa chasteté sous la garde de sa charité, la plus belle des vertus sous la plus belle des gardes.
Quelles bénédictions n’attirera pas sur la France cette chevalerie de la jeunesse, de la pureté et de la fraternité en faveur du pauvre! Avec la même ardeur que nos pères combattaient autrefois les infidèles en terre sainte, ils combattent aujourd’hui l’incroyance, la débauche et la misère, sur cette autre terre sainte de la patrie. Que la patrie protège leur liberté de sa reconnaissance, et vous, Messieurs, assemblés ici précisément en faveur de cette oeuvre, ne considérez pas seulement dans vos bienfaits les pauvres qui en attendent le secours, mais aussi la main qui vous sollicite pour eux. Payez à la fois dans l’aumône un double tribut, le tribut de la charité et celui de l’admiration.
Je n’ai pas fini, Messieurs, de vous dire toutes les causes d’espérance qui réjouissent dans notre pays le coeur du chrétien. Où s’est réfugiée, dites-moi, la pénitence chrétienne? Où découvrirez-vous, dans le reste du monde, rien qui égale la solitude, le travail et l’austérité de la Trappe? Après avoir erré, durant vingt-cinq années, de la Suisse à l’Autriche, de l’Autriche à la Russie, de la Russie à la Prusse, partout victime d’une hospitalité passagère et sans entrailles, la Trappe est revenue à la France, son berceau; elle y a multiplié ses maisons, sous la protection de la liberté commune, et jamais, en aucun temps, la vertu de la croix n’a mieux et plus largement fleuri que sous le froc fécond de ces descendants de saint Bernard et de Rancé.
Ne voyez-vous pas aussi, sous toutes les formes, ressusciter l’esprit monastique, cet esprit qui s’éteignait dans l’ancienne France avant même que des lois usurpatrices eussent frappé du marteau les vieux cloîtres tant aimés de nos aïeux? Le Chartreux, le Jésuite, le Capucin, le Bénédictin rapportent à la France leur dévouement multiple, la prière, la science, la parole, la contemplation et l’action, l’exemple de la pauvreté volontaire, le bénéfice de la communauté. Et aujourd’hui même, devant cette foule qui m’écoute et qui ne s’en étonne pas, apparaît, sans audace et sans crainte, le froc séculaire de saint Dominique.
Que sera-ce, si vous arrêtez votre pensée sur les maisons religieuses où les femmes ont réuni leurs vertus sous la tutelle de la pauvreté, de la chasteté et de l’obéissance? Là il ne vous sera plus possible de nombrer les ordres et les oeuvres. La charité a mis le doigt sur les nuances mêmes des besoins; elle a des mains pour les cicatrices autant que pour les blessures. Et pas un scandale depuis quarante ans! pas une plainte! pas un murmure! La liberté a été plus féconde que les vieilles moeurs féodales; elle a tiré des familles plus de suc généreux et dévoué. La France est toujours le pays des saintes femmes, des filles de charité, des soeurs de la Providence et de l’Espérance, des mères du Bon-Pasteur, et quel nom pourrai-je créer, que leur vertu n’ait baptisé déjà?
Mon dernier regard sera sur une église de Paris solitaire il y a peu d’années, aujourd’hui le rendez-vous des âmes de cent pays, qui y prient de près et de loin pour la conversion des pécheurs: c’est vous rappeler Notre-Dame-des-Victoires, et terminer cette courte revue des travaux de la France dans le bien par un nom trop heureux pour qu’il ne soit pas le dernier.
Il est vrai, Messieurs, tous les obstacles ne sont pas vaincus; toutes nos conquêtes ne sont pas acceptées; l’erreur ne voit pas d’un oeil tranquille nos efforts persévérants. La bourgeoisie, qui nous gouverne, n’a pas encore fait acte de réconciliation pleine et entière avec le Christ et Son Église. Mais la bourgeoisie n’est pas une classe à part, inabordable, enfermée dans ses privilèges et ses préjugés; la bourgeoisie, c’est nous tous. Par un bout, elle touche au peuple, où elle se recrute incessamment, et, par l’autre bout, à la noblesse et au trône, dont ses membres d’élite tendent à se rapprocher par l’inévitable attrait de la distinction pour tout ce qui est distingué. Cette classe est donc mobile, sans cesse renouvelée par l’ascension de ses parties inférieures, qui ne lui permettent pas de se créer un esprit à toujours, et sujette aussi au souffle qui vient des hautes régions. Dieu a dit à la bourgeoisie française: Tu veux régner, règne! Tu apprendras ce qu’il en coûte pour gouverner les hommes, tu jugeras s’il est possible de les gouverner sans Mon Christ. Pourquoi penser qu’elle demeurera toujours ce qu’elle est encore trop généralement aujourd’hui? Pourquoi n’entendrait-elle pas les leçons répétées de l’expérience? Beaucoup de ses fils grossissent déjà nos rangs; ce sont eux qui forment, pour la plus grande partie, la Société de Saint-Vincent-de- Paul, et qui recrutent par leur dévouement les ordres religieux.
Ne désespérons pas d’une classe qui est le fond de la société moderne, et dont l’avènement au pouvoir, signalé par tant de faits considérables, se rattache sans doute au plan général de la Providence. Les difficultés ne doivent qu’animer notre zèle. Elles sont loin d’être aussi fortes qu’il y a cinquante ans, et cependant, dès 1795, le comte de Maistre, entrevoyant l’horizon qui s’est ouvert depuis sous nos yeux, écrivait ces remarquables paroles: «L’esprit religieux n’est pas éteint en France, il y soulèvera des montagnes, il y fera des miracles». Justifions par notre persévérance une prophétie que la résurrection de notre Église place déjà parmi les plus hauts pressentiments de la pensée; rappelons à Dieu les coeurs par la charité, autant que les esprits par la lumière. Que ceux qui travaillent ne se découragent point; que ceux qui n’ont encore rien fait mettent la main à l’oeuvre. Et dans ce moment même, Messieurs, avant de sortir d’ici, unissez-vous au moins par l’aumône à tous les voeux, à tous les efforts, à toutes les prières, à tous les sacrifices, qui depuis cinquante ans montent vers le ciel en faveur de notre patrie.
Monseigneur, la couronne de saint Denis est tombée sur votre tête dans une heure à jamais mémorable, à l’heure où plus que jamais s’opère la réconciliation entre l’Église et la France; j’en ai pour garant cette foule qui se presse autour de votre siége. Je prie Dieu, Monseigneur, que vous portiez longtemps cette couronne. Je ne puis oublier qu’à une autre époque je fus soutenu dans cette chaire par vos conseils et votre affection. L’occasion solennelle de vous en remercier m’avait manqué jusqu’aujourd’hui; je la saisis avec joie. Je me félicite de me retrouver sous les mêmes auspices, au jour où je viens inaugurer l’ordre et l’habit des Frères Prêcheurs français en face de mon pays, et vous achèverez, Monseigneur, de couronner ce moment de ma vie en répandant sur nous votre bénédiction.